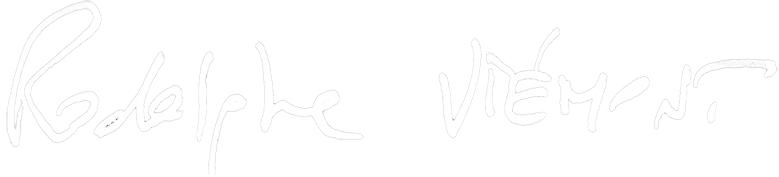Un an après sa triomphale mise en scène du « Soulier de Satin » de Claudel, Olivier Py signe son premier livret d’opéra sur une musique saillante de Suzanne Giraud. « Le Vase de parfum » est une illumination, une explosion d’espérance en un siècle froid, aseptisé, nihiliste. Jour de lumière. Jour d’Apocalypse. Jour de Beauté. La Joie triomphante de la douleur. Retour sur ce chef d’œuvre « contemporain » avant sa tournée mondiale. Explication de texte et digression vers le Beau.
« Alors Marie, prenant une livre d’un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s’emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l’Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit : “Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu’on aurait donnés aux pauvres ?” […]
Jésus dit alors : “Laisse-la : c’est pour le jour de ma sépulture qu’elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.” »
Jean, XII, 3-8
« Oui, je L’ai aimé avec mon corps… »Marie-Madeleine, la Reine du Christ. Marie-Madeleine, son corps, sa peau, son sexe, et son amour tout naturel, simple, Terrestre, au Libérateur. Marie, faite de chair et de sang. Cette chair que les exégètes lui reconnaissent enfin. L’apocryphité de sa relation avec le Seigneur semble désormais éteinte.
Marie-Madeleine n’est plus la « pécheresse », mais une « femme libre », le « treizième apôtre », cette « femme qui s’était donnée et savait le prix de l’amour. » Celle qui verra la première la résurrection, le retour du Christ, la fidèle parmi les fidèles. L’aimante !
Cette Marie, sensuelle, prend corps en une merveilleuse Sandrine Sutter, toute à fleur de peau, de caresses, d’une beauté érotico-mystique, une Madone à l’épaule dénudée, sous le signe de l’amour.
Un lit, un lavabo, un flot d’eau baptismal qui s’épanche, un espoir lumineux et incandescent en la servante de théâtre. Prise entre deux feux, son désespoir et son refus de la Mort, le cynisme de l’Homme du Siècle [Sébastien Lagrave] raillant sa « foi absurde » et l’espérance de l’Ange [Jean-Paul Bonnevalle] l’aidant à porter ses angoisses, Marie-Madeleine veille sa sœur mourante [Mary Saint-Palais]. Veille la Chrétienté dans son ensemble, la certitude qui en ce soir de doute s’est enfuit avec le corps de l’être aimé.
Et que reste-t-il quand tout est parti ? Quand tout nous a été arraché ? Quand l’obscurité nous envahit ?
« La lumière a traversé les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas empêchée. »
Le soir atroce de la Crucifixion du Christ. Lorsque tout espoir semble évanoui, jeté à terre et emmuré. La « Nuit du Vendredi saint, celle-là après la mort du Christ, ou bien l’une de ces nuits parmi les nuits du siècle où la foi n’est plus. » Le sombre du désespoir, de l’inhumanité, du nihilisme aveugle. La nuit comme il en existe des centaines en nos temps abscons, vides et abîmés, meurtris, coincés entre des néo-communistes altermondialistes et des païens néo-fascistes. Sans lumière, sans vie, sans futur, sans espoir. Sans espérance.
Marie est là, esseulée, par cette nuit terrestre, à mi-chemin entre sa foi, fragilisée mais battante, et ses doutes. Perdue, elle résiste pourtant et tend vers la vie, malgré le regard du siècle entier sur sa « bêtise aveugle ».
« L’HOMME DU SIÈCLE. Tu aimes et c’est absurde.
MARIE. J’aime parce que c’est absurde. »
Un état très bernanosien en somme. « Claudel fait preuve d’une foi triomphante, inébranlable et sidérante. Si ces personnages sont déchirés, Dieu est toujours présent. (…) Bernanos, lui, au contraire, raconte dans chacune de ses œuvres l’absence de Dieu. Il en est le poète. Je m’en sens plus proche. Il est l’écrivain du Vendredi saint. Sa recherche correspond à ma propre recherche sur la foi et ce mystère qui fait que, par sa seule force et la grâce de sa liberté intrinsèque, l’homme puisse faire de l’absence une présence ! » [1]
Cette absence, cette mise à l’épreuve de la foi est la liberté même de Marie. Liberté de l’Homme, de ses choix et ses doutes face à Dieu.
« Parce qu’Il m’a voulue libre et que cette liberté est la ténèbre nécessaire où Il a désiré m’éprouver. » Mais la mise à l’épreuve ne serra pas mise à terre : l’Ange « chef d’orchestre (…) veille sur la mesure, que l’homme ne soit pas éprouvé au-delà de l’humain ! »
Et lorsque l’on arrive à accepter cette peur, lorsque les incertitudes font partie intégrante de l’amour, c’est une nouvelle foi, plus grande, plus forte peut-être, qui naît : la Joie…
« Qui parle de croire ? Il me suffit d’adorer. (…) Qui parle d’adorer, il suffit que j’agisse. Croire absolument, non, parce que je suis libre, et mon amour est revêtu d’un manteau absurde. (…)
Je Lui offre cette part de moi qui Le refuse. (…) Si je ne sais croire absolument, puisqu’une part de liberté doit rester hors de la lumière, je peux, dans cette obscurité-là, je peux, ici, au cœur de ma ténèbre, allumer une lampe. »
C’est toute la vie de Marie, la servante du Christ, qui est là : allumer une lampe, une autre servante en l’occurrence ; « la joie d’une lampe » que sa sœur mourante ne percevra qu’à peine – fragilité et tendre délicatesse de la flamme de la Pentecôte. Entretenir sa foi, s’en abreuver, se réchauffer à sa chaleur et jouir. Jouir ! Vivre, espérer, danser ivres « aux fêtes de l’Immanence assouvie ! »
Car telle est bien notre place ici-bas, dans l’attente d’un brasier immense : savoir – oui, savoir – goûter aux prémices et aux flammèches divines. « L’absence est l’immortalité de l’objet au royaume du désir. »
De cette absence, première à la mort du Christ, mais chaque fois répétée lorsque le doute nous assaille, extraire une substance de lumière, une source jaillissante.
« Tout ce qui est accompli librement s’inscrit en lettres infinies dans le ciel. Il en est un écho errant à travers les siècles, la joie d’un ricochet sans fin. »
« C’est de cette absence, de ce silence même que naît cette musique nouvelle. »
« Qu’est-ce qu’il y a quand il n’y a rien ? » Il y a ce que l’on crée, par défi, par foi, par volonté de vivre et de rendre grâce. Une source jaillissante disait-on, musicale en l’occurrence.
Une musique à deux niveaux : celle de Suzanne Giraud, bien sûr (pour laquelle Olivier Py a beaucoup travaillé son écriture, utilisé des mots plus courts, faciles à chanter, lors qu’il jouait dans ses autres textes beaucoup sur les sons) et celle intérieure de Marie.
On se moque de savoir si cette musique que Marie est seule à entendre est une création de son esprit ou si on lui donne à percevoir. C’est surtout son âme en vie qui bat et se bat. C’est la Lumière au cœur de la nuit de l’abandon. Cette musique, c’est juste Marie qui dans le noir espère encore un peu. « C’est de cette chose en moi qui refuse la mort que je fais musique ! Musique et lumière ! » Perdue dans la propre mélodie de l’opéra, le spectateur même n’entend pas cette musique. Mais qu’importe. Elle se referme. Comme un vase clos, l’opéra se boucle parfaitement sur lui-même.
Mais « l’amour se donne [aussi] dans la parole, au-delà d’une grammaire connue, au matin des signes, dans un silence de bénédiction vierge de toute écriture.» Parole et musique. L’opéra est par définition l’art de la foi.
La musique de Suzanne Giraud, lyrique, colle parfaitement au livret. Monteverdienne, mais empreinte d’harmonie toute moderne, elle est en accord parfait avec le texte, chacun servant l’autre à tour de rôle. Vive, poignante, expressive, spirituelle. Où le lyrisme religieux se mélange parfaitement à une fragilité de l’harmonie contemporaine. Ce que Marie traduit en : « C’est à moi de juger si c’est musique ou désaccord. »
En infiltrant la Musique – c’est-à-dire la Vie – au cœur même de la préoccupation du texte (que faire lorsque la présence – donc la croyance – de Dieu s’estompe ?), le message d’Olivier Py est une réussite totale. Il transmet en une poignée de mots aux sens exponentiels – musique, chant, propre foi –, par osmose mystique, cette foi, cet espoir. Sans démonstration aucune, on a pourtant le sentiment que celle-ci est parfaite, pascalienne. Un sentiment où, oui, comme à un office, la beauté jaillit de l’autel.
« Je sais la beauté, la clef de tout c’est la beauté ! »
Cette vie, cette Joie bernanosienne, c’est la Beauté. La Contemplation des choses, l’infinie ivresse de l’âme. Lorsque le politique a tout haché, l’esprit tout catalogué, trié, il reste cet inaltérable : la Beauté.
C’est la nature d’abord dans toute sa magnificence. La mer, le feu. La terre dans sa force primaire et rassurante, sa grandeur et sa puissance. Comme une élévation d’abord esthétique puis spirituelle. Le visage dans la terre, enfoui, transcendé, contaminé de beau.
Ce qu’Olivier Py exprimait en substance [2] par : « Je me suis rendu compte que les grillons chantaient en triolets. Leurs sons sont au rythme exact d’un triolet de croches. C’est admirable. Le monde est un système parfait. » Parfait car divin. La beauté est en toute chose, est la clé de toute chose.
Et l’art dans sa globalité est également une « réponse à cette nuit de l’âme » [1], à nos angoisses, et parfois notre solitude existentielle. Ce sont les dorures, les corps graciles de Botticelli et les madones du Quattrocento. Ce sont les larmes qui coulent pour la première fois sur le corps transpercé de flèches de saint Sébastien. C’est l’émotion pure et belle d’un Lochner ou d’un Giotto.
Jouve, Bloy, Bernanos, Claudel, Tarkovski, Bergman, Pasolini, Bresson, Dreyer. Vibrations, tremblements. Caresser des yeux les corps de Le Bernin, imaginer de chair ceux de Caravage. Glaner le beau, le grand, l’espace infini. Mishima, Lowry, Fauré, Mozart, Bach. S’isoler à Pathmos. S’élever.
Une mise en scène tournée vers le Ciel
Toute la mise en scène du « Vase de Parfum » est tournée vers cela : le beau et l’élévation. Décor épuré, simple, du début du vingtième siècle. Quelque chose de rassurant, de chaud et de glacé en même temps par la pauvreté – dans les deux sens du terme – des éléments, des accessoires. L’eau du lavabo, le lit d’hôpital, la poignée de terre, la croix blanche peinte sur le mur, la lumière qui s’infiltre dans le décor. Chaque élément est signifiant.
Deux directions se dessinent nettement : celle de la négation, horizontale (le plancher de la scène s’ouvre vers des ténèbres d’où sortent – et rentrent – mendiant et Homme du Siècle) ; celle de la foi, une belle verticale asymptotique. L’ensemble du décor et des mouvements est structuré vers le haut : à la mort de la sœur, le lit de la douleur tournoyant s’élève vers le Ciel ; les musiciens, en gradins, et le chœur surplombent la scène : l’Ange, seul, erre par moment entre les violons ; le percussionniste, tout en haut, chapeaute l’ensemble. Orage.
On ressent très vite par cette structure pyramidale une présence divine (deus ex machina ?).
L’intelligence d’Olivier Py, metteur en scène, est qu’il nous « donne à voir la musique et le verbe. » Chez lui, la poésie est « une poésie en action ». [1]
Il n’y a rien de pictural chez Py, je veux dire : purement pictural. Il nous offre une beauté toute vivante, humaine, tournée vers le mouvement, vers l’espérance. Translation. Vers le Ciel bien sûr.
« Et dans la bouche des pauvres entends-tu la musique ? »
Reste que la citation paulienne interpelle peut-être (voir incipit). « Le Vase de Parfum » en est presque une exégèse. Mais l’erreur serait de prendre ce que retranscrit Paul au pied de la lettre. Il n’y a nullement, dans ce « gaspillage » de parfum-argent absence de miséricorde. Mais bien naissance de la miséricorde divine.
L’Homme du Siècle, plein de bons sentiments essaye bien de la culpabiliser : « Vois le monde, Marie ! Et chante avec lui si tu peux ! » Mais il n’est pas question pour Marie de porter quelconque jugement sur la situation du mendiant. Celui-ci a beau rappeler qu’il n’est pas « obscurément complice de [sa] pauvreté. », c’est en vain, car jamais Marie ne nie la pauvreté et la douleur du miséreux.
Marie est miséricordieuse, mais de nature divine. Elle se tourne vers la vie, vers le beau. Accepter la vie n’est pas se désintéresser de la mort. N’est pas la nier. « Ta douleur est mon unique amour » mais « une fois encore je laisse la douleur à sa raison et le pauvre à sa douleur. »
Le message de Marie est clair. Elle montre au mendiant le chemin de la beauté, voire de l’altérité – car quoi de plus non miséricordieux qu’un miséreux ! « Au pied de l’autel, renonce ta souffrance. » Ce qu’elle rejette c’est la volonté toute moderne à se repaître de la douleur, à se l’approprier.
Une position en somme contraire à tout esprit dit maudit. Il n’y a pas d’âme maudite, de corps maudit (exit Rimbaud vu par les bobos) ; juste la croix que chacun porte, à son niveau.
Une œuvre à la mesure de la Foi
« Le Vase de Parfum » est une œuvre clé, une œuvre capitale en ce début de millénaire. Elle renoue avec une vision du monde bien dépassée depuis 50 ans, une vision qu’il fait du bien de réinjecter dans notre siècle. Ne pas nier celui-ci, ne pas s’enfermer avec Bloy dans une logique du tout ou rien, mais savoir voir et ressentir le monde à travers ce prisme là, également.
Cette pièce est tout simplement magistrale, d’une beauté saisissante, tranchante et enveloppante. A voir, à revoir, à lire, à relire, à écouter, à réécouter. Le monde dans un grand brasier d’espoir et de volupté mystique, voilà ce qu’Olivier Py et Suzanne Giraud nous donnent.
Comme Marie, se débarrassant de ses doutes, « Le Vase de Parfum » nous fait marcher « vers le tombeau ouvert comme une lettre, l’Omega d’une alliance nouvelle. »
Alors, qu’y a-t-il au terminus de ce voyage au bout de la nuit, lorsque l’absence nous angoisse et nous réveille ? Il reste beaucoup à vrai dire. L’essentiel même. Il reste « la liberté de cette femme qui s’agenouille dans l’ombre. »
Musique : Suzanne Giraud
Livret, mise en scène, lumière : Olivier Py
Direction musicale : Daniel Kawka
Décor et costumes : Pierre-André Weitz
Avec : Sandrine Sutter (Marie), Jean-Paul Bonnevalle (l’ange), Sébastien Lagrave (l’homme du siècle), Mary Saint-Palais (la mourante), Stephan Imboden (le mendiant)Musiciens : Ensemble Orchestral Contemporain
Choeurs : Ensemble A Sei Voci
Les citations en italique sans notes sont extraites du texte de la pièce.
[1] Extrait du dossier de presse.
[2] Propos extrait de la rencontre avec le public le 16 octobre à Angers.
Interview

Rodolphe Viémont : Je repensai à une citation de Bernanos [1] en préparant cet entretien, que malheureusement je n’ai pas retrouvé, qui définissait la joie. Qu’est-ce que ce mot, dans tout ce qu’il a de catholique, vous inspire ?
Olivier Py : Oui, c’est un mot important pour moi. D’abord parce qu’il est fondamental et puis parce qu’il s’oppose à une idée de bonheur qui serait construit sur du confort intellectuel, sur de l’avoir, sur des choses mortelles. J’ai beaucoup parlé de la joie, dans presque toutes mes œuvres. Mon travail théâtral existe peut-être aussi pour donner une idée de ce que peut être la joie, cette idée si mal comprise aujourd’hui, qui est confondu avec toute sorte de sentiments.
R. V. : La religiosité ?
O. P. : Oui, mais aussi je ne pense pas que la foi chrétienne soit pour tout le monde immédiatement associée à une idée de joie. Et pourtant c’est elle qui est la source de cette foi. Maintenant, est-ce que les œuvres d’art sont susceptibles de nous donner une idée de ce qu’est la joie ? Oui, car l’art en général est une part de cette joie. Une joie qui se voit plus directement. Mais il y a aussi la joie spirituelle… J’aime beaucoup la définition de Spinoza de la joie : une « accession à une vérité plus haute ».
R. V. : La grosse difficulté est de replacer cela dans l’époque actuelle. Saint Paul dans l’« Epître aux Romains » disait : « Ne nous conformons pas à ce siècle. »
O. P. : Le siècle n’est pas mauvais en soi, mais le siècle est une image. Il faut voir à travers le siècle, mais plus encore par le siècle. Passer par le siècle. C’est ça l’idée paulinienne. Ce n’est pas du tout un rejet du temps présent. C’est vivre profondément le présent pour trouver l’éternité parce que sa forme, pour nous, c’est le présent. Donc il n’y a pas de ma part un rejet du siècle. Maintenant, quand il n’y a que le siècle, évidemment il n’y a rien.
R. V. : Est-ce que vous vous sentez pasolinien ?
O. P. : Oui, non. Pas plus que d’autres. J’ai été quelques fois associé à Pasolini. Peut-être à cause de la catholicité et de l’amour des garçons. Mais je crois que la grande différence entre Pasolini est moi, c’est le marxisme. Lui il vivait à une époque où on pouvait encore se vautrer dans le marxisme. Evidemment moi j’ai du mal aujourd’hui à analyser le monde avec la syntaxe marxiste… C’est un grand poète. Je crois que c’est surtout ça qui fait qu’on peut se reconnaître dans un artiste, plus encore que les questions idéologiques.
R. V. : Quel rapport avez-vous à la terre, au corps, à la matière ?
O. P. : Dans la rêverie des matières, ce n’est pas la terre que je choisirais. Je suis plutôt un garçon du feu. C’est pourquoi, presque toujours, la terre évoque plus la mort dans ma grammaire que l’idée de paysage natal. Aussi parce que je suis un homme de la Méditerranée. Je n’ai pas d’origine… j’allais dire terrestre !… Je n’ai pas l’héritage d’une terre, je suis un enfant d’exilés et l’idée d’une terre qui me permettrait d’inscrire mon poème, comme le faisait Claudel par exemple, m’est totalement étrangère. Je suis un vagabond.
R. V. : Ce week-end c’est « Lire en fête ». Que pensez-vous de cette nouvelle forme de culture, manifestations festives etc. ? L’« homo festivus » comme dirait Muray…
O. P. : Je suis un fan de Muray. Quand je suis trop triste, je lis Muray, au moins je rigole. J’ai un mépris profond pour cette dégénérescence du mot « culture ». Aujourd’hui la culture est un plus apporté à des biens de consommation. Je n’ai jamais pensé que la culture était pour tous ! Enfin, si ! C’est pour tous mais quand ça devient Paris Plage, on se demande quel lien il peut y avoir avec la culture. Là je pense qu’il y a une erreur sur le principe de démocratie. La démocratie c’est donner le droit à celui qui est inspiré d’accéder à l’art, et que des contingences sociales ne fassent pas barrière entre celui qui entend et la musique. Mais l’utilisation, la récupération politique, l’ivresse festive (sans joie d’ailleurs !) sont une chose que je trouve infiniment douloureuse. La culture a toujours eu des ennemis mais on les connaît. Mais si à l’intérieur du système culturel, il y a quelque chose qui fait que le culturel remplace la culture, (qui se transforme en quelque chose de pas très loin de la télévision en somme, avec un plus culturel, avec des garanties culturelles) alors là il y a une erreur totale sur le sens de l’œuvre d’art ou du poème. Mais Muray le dit beaucoup mieux que moi…
[1] Il s’agissait de : « (…) la joie. Non pas celle-là, furtive, instable, tantôt prodiguée, tantôt refusée – mais une autre joie plus sûre, profonde, égale, incessante, et pour ainsi dire inexorable – pareille à une autre vie dans la vie, à la dilatation de la vie » in « Sous le soleil de Satan »